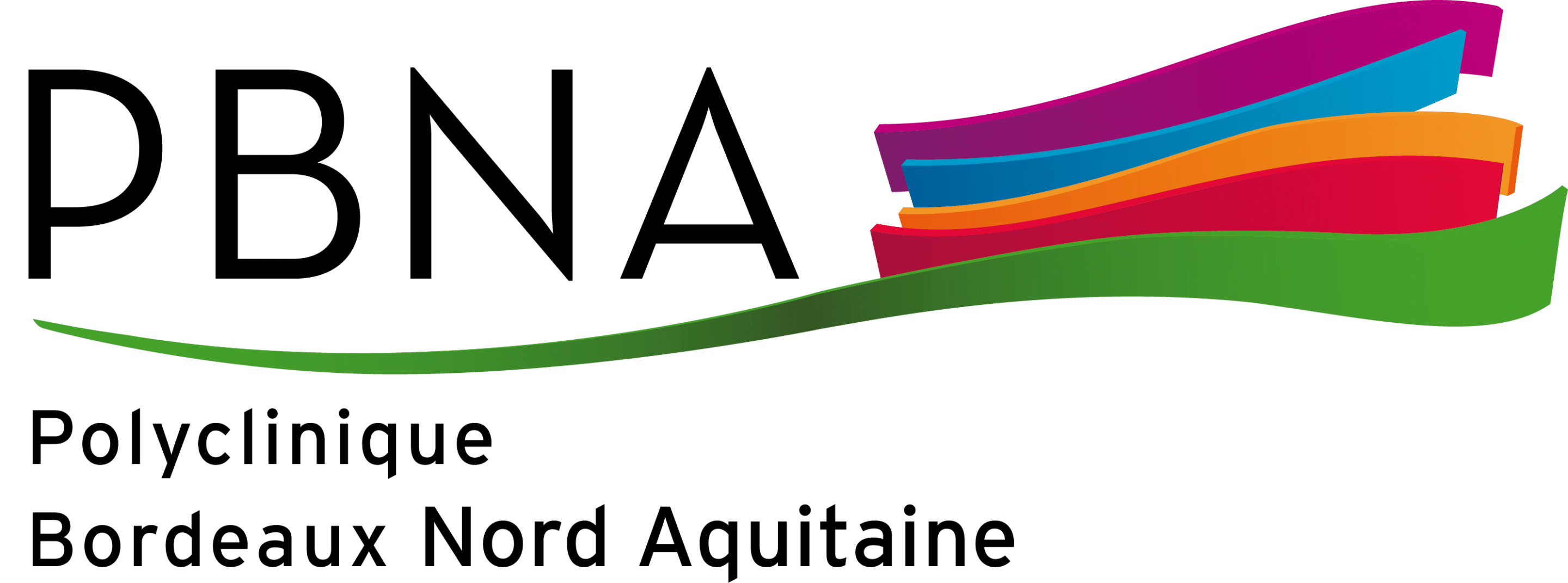« L’anesthésie personnalisée représente un vrai progrès qui améliore considérablement la capacité de récupération des patients, réduit les effets indésirables et diminue les risques intra- et postopératoires. »

Le Pr Philippe Richebé est médecin spécialiste de l’anesthésie et de la prise en charge de la douleur à la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine. Expert international de l’anesthésie personnalisée, il explique comment cette méthode permet de doser précisément les produits anesthésiques et analgésiques aux besoins de chaque patient, ce qui améliore considérablement la récupération et les suites opératoires.
Pouvez-vous nous dire en quelques mots quel a été votre parcours ?
Après des études de médecine à Grenoble, j’ai réalisé mon internat de spécialité en anesthésie-réanimation au CHU de Bordeaux, dont j’ai « gradué » en 2000. J’étais déjà très intéressé par la lutte contre la douleur péri-opératoire et la douleur chronique : j’ai donc entrepris, en parallèle de mon internat, un master puis un doctorat en neurosciences et neuropharmacologie, validés en 2005.
J’ai entrepris un séjour post-doctoral en 2003-2004 aux États-Unis, à Iowa city, où exerçait un éminent spécialiste de la douleur, le Pr Tim Brennan. Une fois rentré en France, j’ai été nommé MCU-PH au CHU de Bordeaux, où j’ai continué mon activité de recherche en neurosciences, neuropharmacologie, douleur, mais aussi en chirurgie cardiaque.
Entre 2000 et 2007, je donnais de nombreuses conférences en Europe et aux États-Unis. J’ai alors été approché par la directrice du département d’anesthésiologie et médecine de la douleur de l’Université de Seattle, qui souhaitait recruter un spécialiste de la recherche fondamentale en neurosciences et douleur. Il faut dire que Seattle a vu la création dans les années 1970 de l’association internationale d’étude et de traitement de la douleur (International Association for the Study of Pain, IASP), et qu’elle abrite la Bonica Pain Clinic, l’un des plus importants centres de prise en charge de la douleur aux États-Unis.
J’ai exercé à Seattle de 2008 à 2014, en tant qu’Associate Professor of anesthesiology and pain medicine (équivalent de PU-PH 1er échelon). J’y ai créé un laboratoire de recherche en neurosciences de la douleur.
Puis, pour des raisons personnelles, en 2014, j’ai décidé de partir exercer à l’université de Montréal au Québec (Canada), qui comprend un important CHU regroupant 7 établissements. J’y ai été Professeur Titulaire, PTG (« professeur régulier Plein Temps Géographique ») régulier permanent d’anesthésiologie et médecine de la douleur et directeur de recherche (chair of research, 2016-2024).
Puis je suis rentré en France et j’ai commencé à exercer à la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine en janvier 2025.
Je suis médecin anesthésiste-réanimateur, médecin de la douleur, chercheur clinicien et directeur de recherche.
Occupez-vous des fonctions dans des sociétés savantes ?
J’ai été membre de nombreux comités scientifiques et d’organisation de congrès provinciaux et nationaux au Québec et au Canada. Je suis éditeur associé pour deux revues scientifiques, le Journal canadien d’anesthésie (CJA) et la revue Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine (ACCPM). Je l’ai aussi été pour la revue Pain Physician aux États-Unis. Je suis aussi relecteur (reviewer) très régulier (plus de 80-100 fois par an) pour plusieurs journaux internationaux d’anesthésie (British Journal of anesthesia, Anaesthesia, Anesthesiology, Pain…). En termes de recherche, j’ai reçu en France, aux États-unis comme au Canada plusieurs bourses et subventions d’institutions ou de sociétés savantes : le National Institute of Health (NIH), les Instituts Recherche Santé Canada (IRSC), la Canadian Anaesthesiologists’ Society, etc. J’ai aussi à mon actif environ 150 articles publiés, une vingtaine de chapitres d’ouvrages, et j’encadre des étudiants dans le cadre de leur recherche doctorale ou post-doctorale en anesthésie et douleur. Je donne des conférences au niveau international, national et provincial, plus de 150 au total. J’ai un emploi du temps bien rempli…

« L’anesthésie du futur consistera à mettre en place une boucle fermée entre les moniteurs et les pompes d’administration de médicaments. »

Quelles sont les innovations les plus marquantes aujourd’hui pour votre exercice ?
Au fur et à mesure des années, j’ai acquis une expertise reconnue à l’international en médecine de la douleur péri-opératoire, douleur chronique et personnalisation de l’anesthésie intra-opératoire. De nouveaux moniteurs permettent aujourd’hui d’administrer les médicaments de l’anesthésie et de la douleur, notamment les opioïdes, selon les besoins de chaque patient et donc de façon extrêmement précise. J’ai beaucoup travaillé et publié sur ce thème ces quinze dernières années [1-12]. Les États-Unis et le Canada connaissent encore aujourd’hui une grave crise des opioïdes, avec des surprescriptions postopératoires qui, d’autant plus quand elles sont associées à des polyconsommations médicamenteuses, provoquent de nombreux décès.
Il est essentiel de travailler au juste dosage des opioïdes. Ce sujet m’intéresse depuis très longtemps et mon groupe de recherche a notamment montré, en 2005, comment de fortes doses de ces produits mènent, de façon assez paradoxale, à une hypersensibilité et une hyperalgésie postopératoires (opioid-induced hypersensitivity and hyperalgesia). Par la suite, de nombreuses stratégies pharmacologiques ont été mises en œuvre pour lutter contre ce phénomène. Puis, dans les années 2015, des moniteurs de nociception ont commencé à voir le jour. Ils permettent d’évaluer précisément, pendant l’intervention, la réponse des systèmes nerveux périphérique et central de la personne placée sous anesthésie, c’est-à-dire son niveau de douleur. Avec cette technique, la dose d’opioïdes est réduite de 30 % à 40 %, l’hyperalgésie due aux opioïdes est diminuée et la récupération postopératoire est améliorée.
J’ai travaillé pendant des années à la mise en place, à l’évaluation et à la validation de ces moniteurs, en étudiant leurs effets cliniques sur la douleur aiguë et chronique postopératoires. Ils sont en cours d’implantation à la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine et leur nombre va progressivement augmenter dans les prochains mois ou années.
Quel est le principe de l’anesthésie personnalisée ?
Dans les années 2010 et avant, les dosages des anesthésiques intraveineux étaient calculés en mg/kg ou prenaient pour objectif les concentrations-cibles dans le cerveau, selon des modèles pharmacologiques pré-établis sur une population. Il en était de même pour les quantités de gaz d’anesthésie, calculées à partir de la concentration-cible moyenne de gaz dans les poumons (MAC : minimum alveolar concentration). Ces modèles pharmacologiques sont populationnels, c’est-à-dire issus de cohortes de patients, et permettent d’obtenir des moyennes valables globalement pour toute personne. Or, cette dose moyenne peut ne pas convenir à tout le monde, car chaque personne peut avoir une sensibilité différente au produit anesthésique (plus sensible ou moins sensible).
Le modèle qui se développe actuellement est bien différent, puisqu’il est fondé sur l’administration de produits dosés selon les besoins et la sensibilité de chaque patient en temps réel : l’anesthésie est ainsi dite « personnalisée ».
Pendant l’intervention, un moniteur enregistre l’électro-encéphalogramme (EEG) du patient, ce qui permet d’adapter la dose d’hypnotiques en fonction de celui-ci. De la même manière, un moniteur de nociception enregistre les réactions du système nerveux aux stimuli douloureux/nociceptifs intra-opératoires afin d’administrer la plus petite dose efficace d’opioïde. Cette adaptation aux besoins du patient est bien plus précise que celle obtenue en mesurant la variation de la pression artérielle ou de la fréquence cardiaque, technique qui était utilisée avant l’avènement de ces nouveaux moniteurs/index.
Ces moniteurs peuvent être utilisés pour tout type d’anesthésie générale, y compris quand celle-ci est réalisée en complément d’une anesthésie locorégionale. Ils permettent alors d’évaluer l’efficacité du bloc périphérique ou de la péridurale, grâce à la mesure de nociception, et de délivrer la dose minimum d’agents anesthésiques et d’opioïdes grâce à l’EEG et au moniteur de nociception.
Quels sont les enjeux de cette nouvelle méthode ?
L’anesthésie personnalisée représente un vrai progrès qui améliore considérablement la capacité de récupération des patients, réduit les effets indésirables et diminue les risques postopératoires. Cette technique est particulièrement intéressante face au vieillissement de nos populations occidentales : certaines personnes âgées accèdent aujourd’hui à des interventions chirurgicales qui n’auraient pas été envisagées auparavant à cause des risques potentiels de l’anesthésie générale traditionnelle. Ces risques sont notamment l’accélération du déclin cognitif due à de fortes doses d’hypnotiques, voire la survenue d’un délirium imposant une hospitalisation qui pourrait aller jusqu’à 6 jours supplémentaires en moyenne. Les enjeux sont donc importants aussi en matière de disponibilité des lits et de dépenses de santé globales.
Quels sont les perspectives et les sujets de recherche dans ce domaine ?
Je dis souvent à mes patients que l’anesthésie est « un tout » : pendant l’intervention, je surveille à la fois leur état général, le fonctionnement de leur cerveau, de leur cœur, de leurs reins, les saignements, la pression artérielle et tous les paramètres nécessaires, pour que l’intervention se déroule de façon optimale et pour une récupération optimisée. Avec une anesthésie personnalisée, les conséquences d’un surdosage intra-opératoire sont évitées, au premier rang desquelles l’hypotension qui nécessite l’administration de médicaments vasopresseurs. Or, une hypotension prolongée, associée à un fort dosage de vasopresseurs, peut induire des effets indésirables sur le fonctionnement des reins, la cicatrisation, la récupération, le risque d’infection, etc. Par rapport aux protocoles standards, l’anesthésie personnalisée permet d’obtenir un profil hémodynamique beaucoup plus stable pendant l’intervention.
Sans aucun doute, l’impact de ces stratégies d’anesthésie sera considérable dans toutes les chirurgies majeures : colorectale, vasculaire, du rachis, thoracique, etc. Leur évaluation sera réalisée sous deux formes : d’une part en comparant les pratiques (projet de qualité de l’acte), et d’autre part via plusieurs protocoles de recherche, dont un projet hospitalier de recherche clinique (PHRC) multicentrique, en lien avec le CHU de Saint-Étienne. Ce dernier évaluera chez des personnes âgées et fragiles, programmées pour une chirurgie majeure, la morbidité basée sur des scores composites de récupération et consécutive à une anesthésie standard versus personnalisée.
Il a déjà été montré que la récupération du patient était améliorée ; il reste à étudier précisément l’Impact médico-économique de ces protocoles et leur plus-value pour la société tout entière, en termes de trajectoire pour les patients et particulièrement pour les personnes âgées et fragiles.
L’étape d’après, ce sera sans doute l’automatisation, dans 20 à 30 ans. L’anesthésie du futur consistera à mettre en place des boucles fermées, d’une part entre le moniteur d’EEG et une pompe d’administration d’hypnotiques, et d’autre part entre le moniteur de nociception et une pompe d’opioïdes. Le médecin anesthésiste et l’infirmier anesthésiste (IADE) auront alors un rôle de superviseur ; leur travail sera grandement facilité grâce à l’intelligence artificielle qui proposera au soignant des stratégies et options thérapeutiques adaptées aux patients.
Que représente pour vous « l’excellence médicale » ?
Il me semble que l’excellence médicale demande d’actualiser sans cesse ses connaissances, d’évaluer et de questionner ses pratiques, et de toujours chercher à les améliorer. Il n’est pas possible de rester sur ses acquis : la recherche est essentielle pour progresser.
Quel est selon vous le rôle du médecin anesthésiste et du médecin de la douleur dans la société ?
Schématiquement, le rôle du médecin anesthésiste est de limiter ou d’éviter la douleur aiguë ; celui du médecin de la douleur, de lutter contre la douleur chronique. J’exerce dans ces deux domaines depuis plus de 25 ans pour éviter que la douleur aiguë devienne chronique. La douleur chronique (dont la douleur chronique postopératoire) est un véritable fléau en termes de qualité de vie, d’arrêts de travail, de consommation de soins et représente donc un coût majeur pour nos systèmes de santé. Lutter contre la douleur aiguë qui « chronicise » et contre la douleur chronique rend donc un grand service à la société !
Partagez cet article
Propos recueillis par Emmanuelle Barsky
Le 24 juin 2025
Références
- Richebé P, Rivat C, Laulin JP, Maurette P, Simonnet G. Ketamine improves the management of exaggerated postoperative pain observed in perioperative fentanyl-treated rats. 2005 Feb;102(2):421-8. doi: 10.1097/00000542-200502000-00028.
- Joly V, Richebe P, Guignard B, Fletcher D, Maurette P, Sessler DI, Chauvin M. Remifentanil-induced postoperative hyperalgesia and its prevention with small-dose ketamine. Anesthesiology. 2005 Jul;103(1):147-55. doi: 10.1097/00000542-200507000-00022.
- Richebé P, Beaulieu P. Perioperative pain management in the patient treated with opioids: continuing professional development. Can J Anaesth. 2009 Dec;56(12):969-81. English, French. doi: 10.1007/s12630-009-9202-y.
- Richebé P, Pouquet O, Jelacic S, Mehta S, Calderon J, Picard W, Rivat C, Cahana A, Janvier G. Target-controlled dosing of remifentanil during cardiac surgery reduces postoperative hyperalgesia. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2011 Dec;25(6):917-25. doi: 10.1053/j.jvca.2011.03.185.
- Richebe P, Cahana A, Rivat C. Tolerance and opioid-induced hyperalgesia. Is a divorce imminent? Pain. 2012 Aug;153(8):1547-1548. doi: 10.1016/j.pain.2012.05.002.
- Richebé P, Rivat C, Liu SS. Perioperative or postoperative nerve block for preventive analgesia: should we care about the timing of our regional anesthesia? Anesth Analg. 2013 May;116(5):969-970. doi: 10.1213/ANE.0b013e31828843c9.
- Rivat C, Bollag L, Richebé P. Mechanisms of regional anaesthesia protection against hyperalgesia and pain chronicization. Curr Opin Anaesthesiol. 2013 Oct;26(5):621-5. doi: 10.1097/01.aco.0000432511.08070.de.
- Shahiri TS, Richard-Lalonde M, Richebé P, Gélinas C. Exploration of the Nociception Level (NOL™) Index for Pain Assessment during Endotracheal Suctioning in Mechanically Ventilated Patients in the Intensive Care Unit: An Observational and Feasibility Study. Pain Manag Nurs. 2020 Oct;21(5):428-434. doi: 10.1016/j.pmn.2020.02.067.
- Renaud-Roy E, Morisson L, Brulotte V, Idrissi M, Godin N, Fortier LP, Verdonck O, Choinière M, Richebé P. Effect of combined intraoperative use of the Nociception Level (NOL) and bispectral (BIS) indexes on desflurane administration. Anaesth Crit Care Pain Med. 2022 Jun;41(3):101081. doi: 10.1016/j.accpm.2022.101081.
- Ghiyasinasab M, Morisson L, Laferrière-Langlois P, Geraldo-Demers MA, Gélinas C, Nadeau-Vallée M, Verdonck O, Lahrichi N, Richebé P. Identification of the intraoperative antinociceptive effect of intravenous fentanyl using the Nociception Level (NOL) index versus clinical parameters in patients undergoing gynecological laparoscopic surgery: A secondary analysis of the NOLGYN study. Anaesth Crit Care Pain Med. 2022 Aug;41(4):101102. doi: 10.1016/j.accpm.2022.101102.
- Coeckelenbergh S, Richebé P, Longrois D, Joosten A, De Hert S. Current trends in anesthetic depth and antinociception monitoring: an international survey. J Clin Monit Comput. 2022 Oct;36(5):1407-1422. doi: 10.1007/s10877-021-00781-2.
- Laferrière-Langlois P, Morisson L, Jeffries S, Duclos C, Espitalier F, Richebé P. Depth of Anesthesia and Nociception Monitoring: Current State and Vision For 2050. Anesth Analg. 2024 Feb 1;138(2):295-307. doi: 10.1213/ANE.0000000000006860.