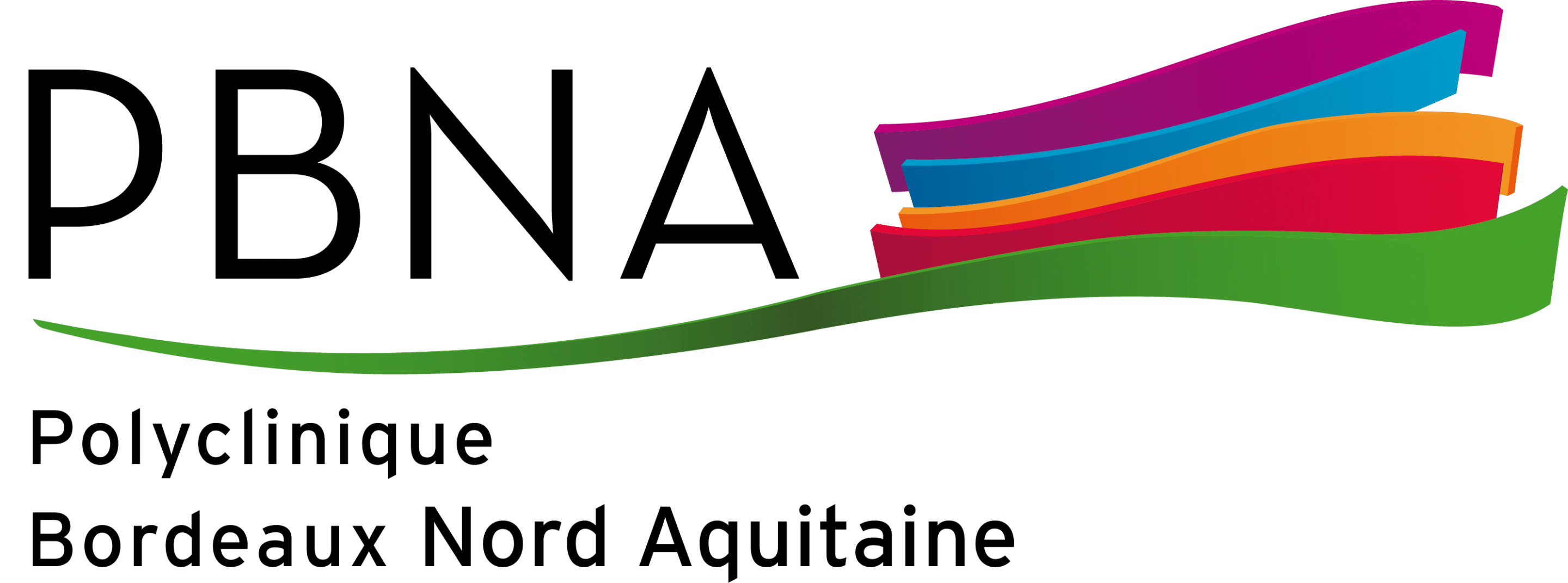Le Dr Céline Halb exerce à la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine en tant que pédiatre spécialisée en gastro-entérologie. Elle rencontre de jeunes patients de la naissance à l’adolescence, avec une grande variété de pathologies : maladies congénitales du système digestif, reflux gastro-œsophagien, allergies et intolérances alimentaires, troubles fonctionnels intestinaux, maladies inflammatoires chroniques de l’intestin… Son activité comprend à la fois les consultations et la réalisation d’explorations fonctionnelles au bloc opératoire. Du diagnostic au traitement hospitalier, quand il est nécessaire, les familles disposent des mêmes interlocuteurs tout au long du parcours de soins.
Pouvez-vous nous dire en quelques mots quel a été votre parcours ?
Mon père était pédiatre et je souhaitais suivre ses traces. Pendant mon externat de médecine, j’étais passionnée par la gastro-entérologie adulte, tout en me destinant à devenir pédiatre. Lors de mon internat de pédiatrie générale en 2006-2010, à Reims, j’ai décidé de me spécialiser en gastro-entérologie et j’ai pu concilier les deux spécialités qui me passionnent, en devenant gastro-pédiatre.
J’ai été chef de clinique de 2010 à 2012 puis, grâce à une bourse américaine, je suis partie pendant un an au CHU Sainte-Justine à Montréal, dont le pôle de gastro-entérologie est une référence en la matière. Ensuite, j’ai exercé au CHU Reine Fabiola à Bruxelles pendant 3 ans, de 2014 à 2017, puis je suis retournée en France pour m’installer du côté de Bordeaux, dont une partie de ma famille est originaire. J’avais aussi le souhait de quitter l’hôpital public pour bénéficier de conditions de travail plus flexibles. J’ai été recrutée à la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine afin de développer l’activité de gastro-entérologie pédiatrique. Aujourd’hui, nous sommes huit praticiens intervenant au sein du Groupe Pédia Nord : cinq chirurgiens (trois orthopédistes et deux chirurgiens viscéraux), deux gastro-entérologues et un endocrinologue, tous spécialisés en pédiatrie. Nous travaillons en équipe : c’est très enrichissant et c’est un gage de qualité pour la prise en charge de nos jeunes patients.
Nous disposons à la clinique des moyens de réaliser les investigations nécessaires pour établir un diagnostic rapidement, avec un large panel d’explorations fonctionnelles : fibroscopie, coloscopie, pH-métrie, test d’intolérance au lactose, etc. Nous disposons pour cela d’un bloc opératoire pédiatrique et d’un service de dix lits d’hospitalisation de chirurgie et deux lits de pédiatrie. L’équipement de pointe adapté aux enfants, qui a été mis en place grâce à des investissements importants de la clinique, représente un avantage indéniable pour les familles comme pour les médecins, car le diagnostic peut ainsi être confirmé sur place et rapidement. Nous avons la possibilité de réaliser ces examens en ambulatoire sur la journée, ce qui améliore le confort des patients et rassure les familles.
Le traitement des Mici est également réalisé dans le service ; il faut savoir que la mise en place d’une perfusion intraveineuse d’anti-inflammatoires ne peut être effectuée qu’en milieu hospitalier.
Ainsi nous sommes en capacité de réaliser la prise en charge de la maladie dans son ensemble, du diagnostic au traitement, sur un même lieu. C’est très rassurant pour les familles, qui ont les mêmes interlocuteurs tout au long de leurs parcours, que ce soit le médecin, les infirmières puéricultrices, les auxiliaires de puériculture et les aides-soignantes, les infirmières de bloc, etc. Cela permet de construire une relation soignante de qualité avec les jeunes patients, d’autant plus en présence d’une maladie chronique comme les Mici.


Notre spécificité tient aussi au fait que nos patients sont des êtres en développement : l’enjeu diagnostique est extrêmement important afin de favoriser au mieux leur croissance, leur développement pubertaire et leur bien-être. Et ce n’est pas la même chose d’être atteint d’une maladie chronique dès l’âge de 10 ans ou à 50 ans, quand on sait que le traitement devra être pris à vie… Les enjeux et les conséquences ne sont pas les mêmes. C’est d’ailleurs aussi pour cela que la présence d’infirmières puéricultrices dans le service est essentielle, car elles sont spécialisées dans l’accompagnement des enfants et des familles.
Enfin, à la différence de la médecine d’adultes, nous sommes dans une relation triangulaire avec l’enfant et ses parents : c’est une approche très particulière. Je m’adresse toujours à l’enfant ou à l’adolescent personnellement, mais bien entendu, les parents sont inclus dans les échanges et les décisions à prendre. Et quand il s’agit d’un nourrisson, ils me communiquent les symptômes et les signes qu’ils ont observés. Il est très important de faire confiance au ressenti des parents : ce sont eux qui connaissent le mieux leur enfant.
Je suis en lien étroit avec les gastro-entérologues des services d’adultes, qui ont une connaissance et une expérience approfondie des Mici. Nous échangeons régulièrement sur des problématiques particulières ou sur des études cliniques portant sur l’évolution et le traitement de ces maladies, tout en sachant que les résultats ne seront pas forcément transposables à l’enfant…
Je suis aussi amenée à solliciter les pneumologues et les allergologues, notamment en cas d’allergie alimentaire.
Le lien avec les médecins traitants est lui aussi primordial : ils doivent pouvoir nous solliciter et nous adresser les familles rapidement pour que le diagnostic et le traitement soient mis en place dans les meilleurs délais. C’est particulièrement important en cas de maladies comme les Mici, qui affectent la croissance et le développement de l’enfant.
Je fais partie du Groupe francophone d’hépatologie, gastro-entérologie et nutrition pédiatriques (GFHGNP). Je me rends régulièrement aux congrès de la Société européenne de gastroentérologie, hépatologie et nutrition pédiatrique (European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition, ESPGHAN) car il est important de se tenir au courant des dernières avancées dans notre domaine.
Plus particulièrement en gastro-entérologie pédiatrique, les Mici sont vraiment une préoccupation car elles sont en forte augmentation dans nos pays occidentaux. Aujourd’hui, nous disposons de traitements efficaces, mais l’évolution de la maladie montre de grandes variations interindividuelles et nous manquons d’éléments pronostiques, d’autant plus quand les symptômes sont apparus à un jeune âge. Il est donc primordial d’établir un diagnostic précis, le plus précocement possible.
Je constate aussi que les troubles fonctionnels intestinaux, comme la constipation chronique, augmentent fortement chez les adolescents, qui montrent beaucoup d’anxiété, particulièrement depuis la crise sanitaire du Covid-19. Ils sont préoccupés par l’actualité en France et dans le monde, par les questions environnementales et écologiques, et s’inquiètent pour leur avenir. Il est important de prendre le temps de les écouter et, si besoin, de les orienter vers un accompagnement psychologique.
En matière de nutrition, j’observe que les familles ne sont pas toutes informées de manière correcte quant à l’équilibre des repas et aux apports nutritionnels recommandés. Nos conseils sont importants pour que de bonnes habitudes alimentaires soient mises en place dès le plus jeune âge, d’autant plus dans un contexte d’obésité infantile croissante dans notre pays.
Les progrès en matière de techniques radiologiques pourraient aussi peut-être, à l’avenir, limiter les indications des explorations fonctionnelles invasives, mais nous n’en sommes pas encore là.
Dans une moindre mesure, les préparations de coloscopie ont fait des progrès considérables, une simplification a permis une meilleure acceptabilité et un meilleur résultat.


Les maladies inflammatoires du tube digestif sont liées à une dysrégulation du système inflammatoire. Il existe aujourd’hui des traitements assez efficaces, en perfusion, pour limiter ce phénomène inflammatoire, et des études sur de nouvelles molécules prometteuses sont en cours. Cependant, les taux de réponses aux traitements sont de 60 % à 80 % selon les patients, ce qui n’est pas encore totalement satisfaisant.
Par ailleurs, les maladies de Crohn et les rectocolites hémorragiques se divisent en plusieurs sous-classes de pathologies ayant chacune ses spécificités (atteintes « simples » ou plus sévères, sur une durée plus ou moins longue, associées à une sténose et/ou une inflammation, etc). Mieux connaître la maladie nous permettra sans doute de mieux traiter nos patients : c’est pour cela que la recherche est indispensable.
Par ailleurs, j’estime que l’on ne peut pas être excellent si on ne travaille pas en équipe : c’est bénéfique à la fois pour les patients et pour les professionnels.
Enfin, une formation médicale continue de qualité est indispensable.
Par ailleurs, il me semble que les cliniques devraient pouvoir accueillir plus d’internes et de jeunes médecins, à l’image de ce qui est réalisé à l’hôpital public. Il me tient particulièrement à cœur de former la jeune génération de médecins, car cela est bénéfique pour tous.
Partagez cet article
Propos recueillis par Emmanuelle Barsky